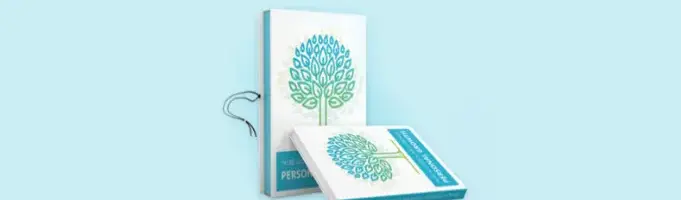Vous avez subi, ou pensez avoir subi un aléa thérapeutique médical par un professionnel de santé ? Indemnisation Préjudice et ses avocats partenaires vous accompagnent dans vos démarches d’indemnisation. N’hésitez pas à nous contacter pour être conseillé sur la marche à suive pour ouvrir un dossier de demande d’indemnisation lié à un aléa thérapeutique.
Définition de l’alea therapeutique (selon le Code de la santé publique)
L’aléa thérapeutique est défini par l’article L.1142-1 du Code de la santé publique comme un dommage anormal survenu lors d’un acte médical en l’absence de faute. La loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, a instauré un système d’indemnisation fondé sur la solidarité nationale, confié à l’ONIAM, pour les victimes de dommages graves répondant à ces critères.
Cette notion repose sur trois éléments essentiels :
- l’imprévisibilité du dommage ;
- l’absence de manquement aux règles de l’art (absence de faute)
- l’anormalité du dommage
L’aléa thérapeutique peut être du à un fâcheux concours de circonstances ou tout simplement au hasard, ce qui peut être difficile à admettre pour la victime qui en subit les conséquences. Même si a priori on ne peut incriminer le soignant, il faudra tout de même revenir sur les circonstances de l’accident médical pour en tirer les conclusions et demander réparation, même pour un accident non fautif.

Victime d’un aléa thérapeutique, obtenez la meilleure indemnisation.
Soumettez nous votre dossier pour une analyse gratuite et sans engagement.
Mise en relation avec des avocats spécialisés.
Comment savoir si un dommage relève d’un aléa thérapeutique ?
L’évaluation repose sur l’étude du dossier médical et sur une expertise indépendante organisée par la CCI.
Les éléments pris en compte sont :
- les circonstances médicales exactes de l’acte ;
- l’état antérieur du patient ;
- l’évolution prévisible de son état ;
- le risque connu et sa probabilité ;
- la conformité de l’acte médical selon les règles de l’art
Certaines complications peuvent être constatés immédiatement par le soignant et la victime, mais dans certains cas, les conséquences anormales d’un soin peuvent apparaître plus tard chez le patient. Les délais d’apparition n’excluent pas la reconnaissance d’un aléa thérapeutique si le dommage est lié à l’acte et s’il présente un caractère anormal.
EVALUER VOS PREJUDICES
RECEVEZ NOTRE GUIDE GRATUIT
Les trois catégories d’accidents médicaux indemnisables
- L’accident médical non fautif : une intervention chirurgicale a été faite dans les règles de l’art mais n’a pas amélioré l’état du patient. Exemples : Une opération du dos n’a pas eu de résultats sur le handicap du patient, il en est au même point qu’avant l’opération. Un patient fait une réaction allergique imprévisible au cours d’une opération, il n’avait pas d’antécédents allergiques. Cet accident non fautif correspond souvent à un aléa thérapeutique.
- L’infection nosocomiale : l’infection a été contractée dans l’établissement hospitalier, pendant l’hospitalisation. Exemple : un patient a contracté un staphylocoque au service de réanimation. Certaines infections nosocomiales peuvent être assimilées à un aléa thérapeutique lorsqu’aucune faute n’est retenue.
- L’affection iatrogène : les conséquences indésirables d’un acte médical ou d’un traitement visant à améliorer l’état de santé du patient. Exemple : une opération qui a provoqué des conséquences neurologiques. Là encore, la qualification d’aléa thérapeutique peut s’appliquer lorsqu’il n’existe aucune faute médicale.
Procédure d’indemnisation d’un aléa thérapeutique : CCI et ONIAM
Les lois et organismes pour l’indemnisation d’un aléa thérapeutique
La CCI et l’ONIAM sont les deux instances qui se chargent de l’indemnisation des accidents médicaux et aléas thérapeutiques. Elles permettent ainsi aux victimes de lancer une procédure pour obtenir des indemnités pour le préjudice subi suite à un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale. Ces organismes interviennent directement lorsque l’aléa thérapeutique est reconnu par l’expertise.
Selon la gravité du préjudice, la procédure sera celle de la conciliation ou celle du règlement amiable : « La commission siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de conciliation » (Art. L. 1142-5).
Depuis la loi Kouchner du 4 mars 2002, lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1, l’office adresse à la victime ou ses ayants droit dans les quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation pour une réparation intégrale des préjudices. Ce mécanisme est celui qui s’applique spécifiquement à l’aléa thérapeutique.
Conditions légales d’indemnisation d’un aléa thérapeutique (article L.1142-1 du CSP)
Pour faire intervenir la CCI, la Loi Kouchner de 2002 demande à ce que la victime remplisse au moins l’une des conditions suivantes :
- Avoir un taux d’Aipp (atteinte à l’intégrité physique ou psychique) d’au moins 24 %
- Un arrêt temporaire des activités professionnelles d’au moins 6 mois sur une période de 12 mois
- Un DFT(Déficit Fonctionnel Temporaire) d’au moins 50% pendant au moins 6 mois sur une période de 12 mois
- Une incapacité à reprendre l’activité professionnelle exercée avant l’accident médical
- Des troubles graves dans les conditions d’existence
La procédure d’indemnisation d’un aléa thérapeutique
La saisine de la CCI est une étape centrale. La commission examine la recevabilité du dossier, organise l’expertise et rend un avis motivé.
Les étapes de la procédure sont les suivantes :
- Obtention du dossier médical : récupérer le dossier médical auprès de l’établissement ou du praticien concerné
- Dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès de la CCI accompagné du dossier médical
- Expertise médicale : la CCI organisera une expertise afin de confirmer ou non l’aléa thérapeutique et procéder à l’évaluation des dommages (AIPP, DFT)
- Avis de la CCI : la CCI rend un avis à l’issue de l’expertise
- Offre d’indemnisation par l’ONIAM dans un délai de quatre mois (article L.1142-22) : l’Oniam procéde ensuite au chiffrage selon les barèmes de l’ONIAM et propose une offre d’indemnisation. L’offre d’indemnisation basée sur le rapport d’expertise couvrira tous les postes de préjudices, professionnels mais aussi préjudices physiques, psychologiques, familiaux ou financiers consécutifs à l’accident médical non fautif.
- Acceptation ou Contestation par la victime : Si la victime conteste l’avis ou l’offre, elle peut saisir les tribunaux compétents. Ces recours sont prévus par les articles L.1142-23 et suivants.
Exemple des dossiers d’indemnisation d’aléa thérapeutique :
Indemnisation Aléa thérapeutique suite à une opération chirurgicale
Circonstances de l’aléa thérapeutique
Madame a eu une première hospitalisation en octobre 2016 qui a duré plus de 5 jours en clinique. En sortant, elle est allée directement dans un centre de rééducation durant 35 jours en hospitalisation complète et 4 mois en hospitalisation de jour.
Dommages corporels suite à l’aléa thérapeutique
Les préjudices corporels :
- Hémianesthesie selle droite.
- Déficit pied droit (chaussures Ortho et opération prévu pour double arthrodèse)
- Douleurs neurologiques : traitement (Lyrica 150mg×2, laroxyl10 gouttes le soir, baclofène 3cp/jour, patch verdztus tous les soir, ixprim et rivotril à la demande si grosses douleurs, perf lidocaine et ketamine 3 jours par mois patch qutenza tous les mois.
Depuis l’expertise, la douleur est toujours malheureusement là ( les médicaments et les hospitalisations régulières tous les mois 3 jours pour des perfusions de lidocaïne et kétamine peuvent le prouver).
Madame s’est ensuite faite opérée de son pied gauche en janvier 2019. A présent, elle ne met des chaussures orthopédiques que si elle doit marcher dans un lieu un peu accidenté. Sinon elle dispose d’une attèle qui lui soulève le pied car elle n’a plus de releveurs. Madame marche toujours avec une canne, sauf à la maison.
Situation du dossier avant prise en charge par Indemnisation Préjudice
Madame a eu expertise CCI. La CCI a confirmé que c’était bien un aléa thérapeutique, le chirurgien n’y est pour rien. La CCI a évalué la Souffrance Endurée à 4/7 et le Déficit Fonctionnel Permanent : 30 %. Elle a reçu un remboursement de 3600 euros de l’Oniam pour les premiers gestes de la vie courante, le reste devant être indemnisable par la GAV de la victime.
Mme a donc transmis à sa GAV qui a émis une proposition.
La proposition de la GAV, ne convient pas à Madame car le médecin conseil de la GAV a remis en cause certains éléments du rapport d’expertise de la CCI avec :
- Un préjudice esthétique qui n’est plus du tout mentionné,
- Une Souffrance Endurée qui est passée de 4 à 2,5,
- Un taux de Déficit Fonctionnel Permanent qui est passé de 30% à 25%,
- Une réduction de l’aide ménagère
Mme a donc demandé un avis à Indemnisation Préjudice par rapport à la proposition de la partie adverse. L’équipe Indemnisation Préjudice l’a orienté vers un avocat spécialisé en droit médical afin d’obtenir une meilleure indemnisation.
Indemnisation Aléa thérapeutique suite à une infection nosocomiale
La victime d’une infection nosocomiale, artisan à son compte, a du cesser son activité professionnelle pendant un an et embaucher un remplaçant pendant cette période. Suite à cette infection, elle a gardé un handicap à la jambe qui complique sa vie quotidienne. Ce type de situation correspond à un aléa thérapeutique dès lors qu’aucune faute n’est démontrée.
La loi KOUCHNER de 2002 prévoit une indemnisation de l’ aléa thérapeutique si la victime a une ITT de plus de 6 mois ou d’une IPP de plus de 24 % ou une inaptitude définitive à exercer son activité professionnelle ou des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence.
Étant donné qu’il n’y a pas eu de faute médicale, c’est à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et de l’ infection nosocomiale (ONIAM) de présenter une offre d’indemnisation à la victime. Ce régime s’applique exclusivement lorsque le dommage relève d’un aléa thérapeutique reconnu par la procédure.
Dans cet exemple, la victime coiffeuse à son compte et mère de famille, devra être indemnisée en plus des souffrances physiques pour le coût du remplaçant, la tierce personne qui a du l’aider pour sa toilette et conduire les enfants à l’école pendant sa convalescence, l’aménagement de son véhicule et de son lieu de vie par rapport à son handicap.
Le montant de l’indemnisation devra prendre en compte le préjudice subi mais aussi les préjudices futurs, les pertes financières et les frais que la victime devra engager pour garder une vie « normale ». C’est l’objectif du dispositif légal d’indemnisation des aléas thérapeutiques.
FAQ Indemnisation Aléa thérapeutique
Qu’est-ce qu’un alea therapeutique ?
Un aléa thérapeutique est un accident médical imprévisible et non fautif : il s’agit de la réalisation d’un risque accidentel inhérent à l’acte de prévention, de diagnostic ou de soins, qui survient alors que le professionnel de santé a respecté les règles de l’art. En pratique, c’est une complication anormale et grave au regard de l’état de santé du patient et de son évolution prévisible, sans qu’aucune faute médicale ne puisse être retenue.
Quelle est la différence entre faute médicale et aléa therapeutique ?
En cas de faute médicale, le professionnel de santé ou l’établissement n’a pas respecté les règles de l’art (erreur de geste, défaut de surveillance, défaut d’information, etc.) et sa responsabilité civile est engagée ; l’indemnisation est alors prise en charge par son assureur en responsabilité civile professionnelle. L’aléa thérapeutique, au contraire, correspond à un dommage anormal et grave survenu en l’absence de faute, du seul fait d’un risque inhérent à l’acte médical ; l’indemnisation relève alors de la solidarité nationale via l’ONIAM, si les critères légaux de gravité sont réunis.
Quelles sont les conditions pour être indemnisé par l’ONIAM en cas d’aléa thérapeutique ?
Pour bénéficier d’une indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, il faut :
- qu’il s’agisse d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, sans faute retenue contre un professionnel, un établissement ou un producteur de produit de santé ;
- que les conséquences présentent un caractère anormal et une gravité suffisante, appréciées notamment au regard d’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur au seuil réglementaire (24%), d’une incapacité temporaire de travail ou d’un déficit fonctionnel temporaire d’au moins six mois (consécutifs ou non) ou encore d’une inaptitude professionnelle définitive ou de troubles graves dans les conditions d’existence.
Quel est le délai pour saisir la CCI après un accident médical ?
La victime dispose d’un délai de prescription de dix ans à compter de la date de consolidation de son état de santé pour saisir la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI). La consolidation correspond au moment où l’état de santé est considéré comme stabilisé, c’est-à-dire n’étant plus susceptible d’évolution
significative en amélioration ou en aggravation.
Qui indemnise un aléa thérapeutique grave ?
En cas d’aléa thérapeutique grave, lorsque aucune faute médicale n’est retenue mais que les critères de gravité légaux sont remplis, l’indemnisation est prise en charge par l’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux) au titre de la solidarité nationale, généralement après avis d’une CCI. Si, au contraire, une faute médicale est reconnue, l’indemnisation relève de l’assureur en responsabilité civile du professionnel de santé ou de l’établissement concerné.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés en cas d’aléa thérapeutique ?
En cas d’aléa thérapeutique indemnisable, la victime peut obtenir la réparation de l’ensemble de ses préjudices selon la nomenclature en vigueur : préjudices corporels (souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire et permanent, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, etc.), préjudices économiques (pertes de revenus, incidence professionnelle, frais professionnels ou de remplacement pour un indépendant), préjudices liés au logement ou au véhicule adapté et préjudices subis par les proches (aide humaine, préjudice d’accompagnement, etc.). L’évaluation chiffrée s’appuie sur le rapport d’expertise médicale et le référentiel indicatif d’indemnisation de l’ONIAM.