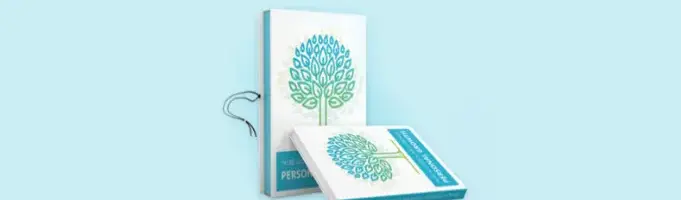Prise en charge hospitalière du patient polytraumatisé
Le patient polytraumatisé : les défis de l’accueil hospitalier (A. Ricard-Hibon, S. Hamada, T. Gauss)
La traumatologie grave constitue un problème majeur de santé publique : elle provoque des décès précoces et de lourds handicaps. Les études françaises démontrent qu’une médicalisation préhospitalière précoce réduit significativement la mortalité. L’enjeu principal est d’assurer la continuité d’une prise en charge rapide, coordonnée et adaptée depuis l’appel initial jusqu’à l’accueil dans une structure disposant du plateau technique complet.
Les bonnes pratiques à respecter sont :
- Une préparation avant l’arrivée
- Une équipe de traumatologie réduite et identifiée
- Un lieu d’accueil adapté
- Une prise en charge initiale efficace
- Un Bilan lésionnel initial
- Une procédure d’alerte et anticipation du choc hémorragique
- Un bilan lésionnel secondaire : le scanner corps entier
Préparation avant l’arrivée du blessé
L’accueil d’un polytraumatisé ne s’improvise jamais. Dès l’appel du SAMU, un échange structuré doit informer le médecin hospitalier responsable, le trauma leader, des lésions suspectées et de la gravité clinique. Cette communication de sénior à sénior permet de mobiliser sans délai les ressources nécessaires.
L’activation d’un niveau d’alerte, fondé sur les critères de gravité (comme ceux de Vittel), déclenche la mise en route d’une équipe dédiée et l’organisation logistique du lieu d’accueil (SAUV). Les systèmes imposant de multiples intermédiaires avant l’acceptation d’un patient sont proscrits, car ils entraînent des retards préjudiciables.
Équipe médicale et coordination
L’équipe doit être réduite mais identifiée :
-
un seul trauma leader (urgentiste ou anesthésiste-réanimateur) coordonne et décide ;
-
un médecin « technicien » exécute les gestes médicaux ;
-
un infirmier référent supervise les soins techniques, assisté d’un second infirmier et d’un aide-soignant ;
-
les chirurgiens spécialistes (viscéral, orthopédiste, neurochirurgien, thoracique-vasculaire) participent à la concertation dès l’arrivée ;
-
un radiologue est recommandé pour guider le bilan initial.
Le trauma leader doit être expérimenté, capable de garder la vision d’ensemble sans se laisser absorber par les tâches manuelles. La communication entre les membres doit être fluide, directe et non hiérarchiquement bloquante.
Salle d’accueil des urgences vitales
La Salle d’Accueil des Urgences Vitales (SAUV), conforme aux recommandations SFAR-SFMU-SRLF, doit être vérifiée par une check-list avant chaque prise de service et avant l’arrivée du patient. Le matériel, les voies d’accès, la radiologie et la biologie doivent être immédiatement disponibles. L’objectif est d’assurer un fonctionnement opérationnel sans délai à la minute d’arrivée.
À la réception du patient, la transmission orale et écrite entre le médecin du SMUR et le trauma leader est capitale pour comprendre les mécanismes du traumatisme. En cas d’instabilité hémodynamique extrême, l’accueil peut se faire directement au bloc opératoire.
Les gestes prioritaires concernent la sécurisation des voies aériennes, la ventilation, la recherche d’une hémorragie traitable et la prévention de l’hypothermie. Des mesures immédiates (hémoglobine, glycémie, gaz du sang, coagulation) guident la réanimation.
La coordination doit être rigoureuse pour éviter les pertes de temps. Le trauma leader dirige sans participer aux manipulations afin de garder la maîtrise du temps et de la stratégie.
Bilan lésionnel initial et scanner corps entier
Bilan lésionnel initial
Trois examens fondamentaux constituent le socle du diagnostic rapide :
-
échographie abdominale et thoracique (méthode FAST) pour détecter saignements intra-abdominaux, pneumothorax ou épanchements péricardiques ;
-
radiographie du thorax pour identifier pneumothorax, contusions, mauvaise position de sonde ou rupture aortique (signes typiques : médiastin élargi, effacement du bouton aortique, déviation trachéale, etc.) ;
-
radiographie du bassin utile seulement en cas de choc hémorragique pour orienter vers une embolisation ou un geste de stabilisation.
Ces examens doivent être réalisés immédiatement, sur place, sans interrompre la réanimation.
Une procédure d’alerte et anticipation du choc hémorragique
Dès le préhospitalier, des critères cliniques permettent d’identifier les patients à haut risque d’instabilité et de déclencher une alerte maximale. Ce protocole inclut la préparation simultanée du bloc opératoire, de la salle d’imagerie interventionnelle, du réchauffement et des produits sanguins.
La décision d’aller au scanner ou au bloc dépend de la stabilité évaluée par le trauma leader. En cas d’état incontrôlable, la chirurgie de damage control (hémostase rapide et temporaire) s’impose avant tout examen complémentaire.
Un bilan lésionnel secondaire : le scanner corps entier
Une fois le patient stabilisé, un scanner corps entier est recommandé pour établir un diagnostic exhaustif (cerveau, thorax, abdomen, rachis, pelvis). Les études, notamment celle de Huber-Wagner (Lancet, 2009), montrent une réduction significative de la mortalité chez les patients ayant bénéficié d’un tel examen.
L’interprétation des images se fait en concertation pluridisciplinaire, directement à la console, pour hiérarchiser les lésions et planifier les gestes thérapeutiques ultérieurs.
Sources : Ricard-Hibon A., Hamada S., Gauss T., « Le patient polytraumatisé : les défis de l’accueil hospitalier », in Les traumatisés graves, CHU Bicêtre & Beaujon, 2011.)