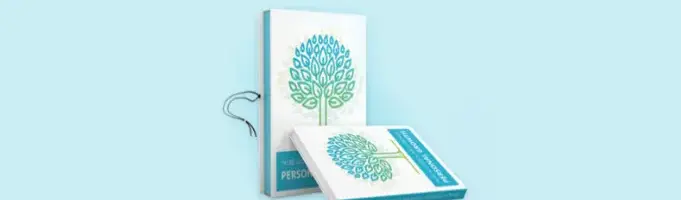L’agression au travail (qu’elle soit verbale, physique, psychologique ou sexuelle) est considérée comme une atteinte grave aux droits du salarié. Elle peut provenir d’un collègue, d’un supérieur hiérarchique, d’un client ou d’un usager. Une agression peut être reconnue comme accident du travail ou, en cas de séquelles, ouvrir droit à indemnisation.
L’employeur a une obligation de sécurité (Code du travail, art. L.4121-1) : il doit protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Il doit réagir immédiatement : mise à l’écart de l’agresseur, enquête interne, prévention de nouvelles violences. Si l’agresseur est un collègue, l’employeur doit prendre des sanctions disciplinaires. S’il s’agit d’un tiers (client, usager, etc.), il doit mettre en place des mesures de protection adaptées.
Reconnaissance de l’agression comme accident du travail
Une agression survenue pendant le temps et sur le lieu de travail (y compris les déplacements professionnels) peut être reconnue comme un accident du travail. La victime doit :
- Informer l’employeur dans les 24 heures (hors cas de force majeure).
- Consulter un médecin (cabinet ou hôpital), qui établira un certificat médical initial.
- L’employeur déclare ensuite l’accident à la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie)
La victime a la possibilité de porter plainte contre son agresseur et avoir recours à un avocat.
Responsabilité de l’agresseur (collègue, client ou tiers)
Si l’agresseur est un collègue
- Responsabilité disciplinaire :
L’employeur doit sanctionner le salarié fautif (avertissement, mise à pied, licenciement pour faute grave). - Responsabilité pénale :
La victime peut porter plainte : l’agresseur encourt des peines selon la gravité (violences, menaces, harcèlement…). - Responsabilité civile :
En principe, les actes commis par un salarié dans le cadre de son travail engagent d’abord la responsabilité de l’employeur (article 1242 Code civil).
Mais l’agresseur peut être poursuivi personnellement s’il a commis une faute intentionnelle (ex. violences volontaires).
Si l’agresseur est un supérieur hiérarchique
- Idem qu’un collègue, mais avec une aggravation possible :
- Abus d’autorité pris en compte par le juge.
- Possibilité de harcèlement moral ou sexuel reconnu (avec sanctions pénales spécifiques).
- L’employeur, en tant que personne morale, peut aussi être poursuivi s’il a laissé faire.
Si l’agresseur est un client, usager ou tiers extérieur à l’entreprise
- Responsabilité pénale directe :
La victime peut porter plainte contre le tiers (comme pour toute agression). - Responsabilité civile :
Le tiers peut être condamné à indemniser la victime (dommages et intérêts). - Responsabilité de l’employeur :
L’employeur reste tenu d’assurer la protection du salarié, même contre des tiers (ex. caissier agressé par un client). S’il n’a rien fait pour prévenir le risque, il peut être tenu pour fautif.
Obligation de sécurité de l’employeur
Vos droits à la sécurité : L’employeur a une obligation légale de protéger la santé physique et mentale de ses salariés (Code du travail, art. L. 4121-1).
Obtenez la meilleure indemnisation si vous êtes victime d’une agression au travail.
Envoi gratuit d’un guide sur l’expertise médicale et l’évaluation des préjudices. Mise en relation avec des avocats spécialisés.
Les sanctions pénales et disciplinaires en cas d’agression au travail
Aucune sanction ou licenciement ne peut être fondé sur le fait qu’un salarié a signalé ou dénoncé une agression. En cas de licenciement, celui-ci peut être jugé nul.
Selon l’incapacité temporaire de travail (ITT)
C’est une évaluation faite par un médecin qui indique pendant combien de jours la victime est incapable d’accomplir les gestes de la vie courante (et non seulement de travailler).
Cas de mutilation ou d’infirmité permanente
Les cas de mutilation ou d’infirmité permanente sont considérés comme les formes les plus graves d’agression au travail, avec des conséquences lourdes, tant pour la victime que pour l’agresseur.
Infirmité permanente : perte définitive d’une fonction physique ou psychique (ex. perte d’un œil, paralysie, séquelles neurologiques, traumatisme psychologique durable).
- Mutilation : atteinte irréversible à l’intégrité corporelle (ex. amputation, cicatrice très marquée, invalidité fonctionnelle).
- Le caractère permanent est évalué par un expert médical et peut aboutir à une IPP (Incapacité Permanente Partielle).
Rôle de l’employeur face à l’agression
L’employeur doit mettre en place des mesures pour éviter la récidive (sanctions, changement d’organisation, protection).
EVALUER VOS PREJUDICES
RECEVEZ NOTRE GUIDE GRATUIT
Procédure d’indemnisation pour une agression au travail
Déclarer l’agression comme accident du travail.
- Obtenir un certificat médical initial.
- Vérifier la déclaration CPAM (et contester si refus).
- Déposer plainte pénale contre l’agresseur.
- En cas de séquelles : demander une expertise médicale pour fixer l’IPP.
- Si l’employeur a failli à son obligation de sécurité → engager une procédure pour faute inexcusable.
- Mobiliser les aides complémentaires (CIVI, FGTI, assurances, prévoyance).
Le recours à un avocat du dommage corporel est utile en cas de séquelles permanentes.
Déclaration de l’accident et démarches auprès de l’assurance
En plus de la prise en charge par la Sécurité sociale, la victime peut mobiliser :
- Assurance personnelle (garantie accidents de la vie, contrat d’assurance emprunteur, carte bancaire haut de gamme) : peut indemniser les préjudices non couverts par la CPAM (souffrances endurées, atteinte à la qualité de vie, etc.).
- Assurance habitation (protection juridique incluse) : permet une prise en charge des frais d’avocat ou d’expertise.
Intervention du médecin expert et évaluation du préjudice
- ITT > 8 jours
→ L’agression est qualifiée de violences ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours.
→ Délit puni de prison (jusqu’à 3 ans et 45 000 € d’amende, voire plus si circonstances aggravantes comme un supérieur hiérarchique, usage d’une arme, préméditation, etc.).
- ITT longue durée / infirmité permanente
→ Si l’agression provoque une incapacité permanente partielle (IPP) ou des séquelles graves, les sanctions peuvent être encore plus sévères (jusqu’à plusieurs années de prison).
Le rôle de l’avocat spécialisé en dommage corporel
🔹1. Conseil et accompagnement juridique
- Informe la victime sur ses droits (accident du travail, faute inexcusable de l’employeur, procédure pénale contre l’agresseur, assurances, FGTI).
- Oriente sur les démarches prioritaires (déclaration CPAM, dépôt de plainte, expertise médicale).
- Vérifie que l’employeur respecte son obligation de sécurité.
🔹 2. Gestion des procédures d’indemnisation
- CPAM (accident du travail) : aide à contester un refus de prise en charge ou un taux d’IPP jugé trop faible.
- Faute inexcusable de l’employeur : introduit la procédure devant le tribunal judiciaire pour obtenir une majoration de la rente et des indemnités complémentaires.
- Assurances (prévoyance, GAV, mutuelle) : s’assure que tous les contrats potentiellement mobilisables sont utilisés.
- FGTI : saisit le fonds si l’agresseur est inconnu ou insolvable.
🔹 3. Expertise médicale
- Assiste la victime lors des expertises médicales (CPAM, judiciaire ou amiable).
- Vérifie que les préjudices sont correctement évalués (souffrances endurées, incapacité, perte de revenus, préjudice moral, préjudice esthétique, etc.).
- Peut proposer un médecin conseil de victime pour défendre les intérêts de la personne face aux experts des assurances.
🔹 4. Procédure pénale
- Dépose plainte et peut constituer la victime partie civile pour demander des dommages et intérêts.
- Défend la victime lors de l’audience pénale face à l’agresseur.
- Aide à chiffrer les préjudices selon la nomenclature Dintilhac (référence utilisée par les tribunaux).
🔹 5. Négociation et maximisation de l’indemnisation
- Négocie avec les assureurs et la CPAM pour éviter une sous-indemnisation.
- Évalue le juste montant de l’indemnisation (souvent supérieur aux premières propositions des assurances).
- Défend la victime devant les juridictions en cas de désaccord.
En résumé
L’avocat spécialisé en dommage corporel est l’allié de la victime :
- Il sécurise les démarches,
- optimise les indemnisations,
- et protège contre les stratégies de minimisation des assureurs ou de l’employeur.
Quels préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices patrimoniaux (liés à l’argent ou aux biens).
Préjudices extrapatrimoniaux (liés à la personne).
Préjudice corporel et psychologique (souffrance, séquelles)
Le volet corporel inclut les souffrances endurées : douleurs physiques pendant la période d’ITT et le déficit fonctionnel permanent : perte d’autonomie, limitation des mouvements par exemple. Les séquelles psychologiques peuvent être tout aussi des blessures invalidantes.
Préjudice professionnel et perte de revenus
Le préjudice professionnel désigne les conséquences d’un accident ou d’un dommage sur la carrière et les revenus d’une victime. Il inclut la perte de revenus actuels pendant l’ITT (Incapacité Temporaire Totale), mais aussi la perte de gains futurs si la victime ne peut reprendre son activité ou doit se reconvertir. Ce préjudice peut également couvrir l’incidence professionnelle, comme la dévalorisation sur le marché du travail ou la perte de chance d’évolution.
Préjudice moral et accompagnement familial
Préjudice moral : détresse psychologique, atteinte à la dignité ou à l’honneur
Préjudices des proches
- Préjudice d’affection en cas de décès ou de handicap grave
- Préjudice économique pour les aidants ou les personnes à charge.
Agression au travail : quelle marche à suivre pour lancer la procédure ?
Un dépôt de plainte auprès de la police ou du commissariat est nécessaire. Sur le plan médical, Il faut consulter un médecin le plus rapidement possible. Faire établir un certificat médical initial décrivant les blessures. Garder tous les documents médicaux et ordonnances. Contacter le médecin du travail pour évaluer l’aptitude au poste et demander un aménagement si nécessaire. Les éléments médicaux permettront au juge d’évaluer le préjudice corporel et le déficit permanent.
Action en justice et dépôt de plainte
La victime peut porter plainte contre l’agresseur (collègue, supérieur, tiers) et demander réparation du préjudice (moral, physique, financier) devant le tribunal. L’action pénale peut se cumuler avec la reconnaissance en accident du travail.
Indemnisation par la CIVI ou l’assurance
Un contrat d’assurance personnel ou professionnel peut indemniser des dommages corporels selon le contrat. La CIVI intervient uniquement si l’accident du travail est aussi une infraction pénale (ex. : agression, manquement grave à une obligation de sécurité).
Financement de la procédure (aide juridictionnelle, protection juridique)
L’aide juridictionnelle permet à ceux qui ont de faibles ressources de bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle des frais de justice (avocat, huissier, expert, etc.).
La protection juridique est une garantie souvent incluse dans vos contrats (habitation, auto, carte bancaire, mutuelle…), elle permet la prise en charge des frais d’avocat, d’expertise, de procédure.
Exemple d’accompagnement d’une victime d’agression au travail
L’accompagnement juridique par l’avocat :
1. Accueil et écoute
- L’avocat écoute la victime en consultation au cabinet, ou au téléphone dans un premier temps.
- Il recueille les faits, les circonstances, les documents médicaux et les témoignages.
- Il évalue la qualification juridique : agression physique, infraction pénale, accident du travail.
2. Dépôt de plainte
- L’avocat rédige et dépose la plainte auprès du commissariat ou du procureur.
- Il peut accompagner la victime lors de son audition.
- Il demande l’ouverture d’une enquête et la reconnaissance du statut de victime.
3. Constitution de partie civile
- Si une procédure pénale est engagée, l’avocat constitue la victime partie civile.
- Il demande réparation du préjudice physique, moral et professionnel.
- Il prépare le dossier avec :
- Certificats médicaux
- Attestations de collègues
- Évaluation psychologique
- Justificatifs de perte de revenus
4. Indemnisation
- L’avocat sollicite :
- L’indemnisation via la CPAM (accident du travail)
- Une rente ou capital en cas d’IPP
- Une indemnisation complémentaire via la CIVI si l’agression est une infraction pénale
- Il peut aussi engager une action contre l’employeur en cas de faute inexcusable (manquement à l’obligation de sécurité).
5. Suivi et défense
- L’avocat assiste la victime à chaque étape : expertise médicale, audience, négociation avec les assurances.
- Il veille à ce que les droits de la victime soient respectés et que l’indemnisation soit juste et complète.
Étude du dossier et expertise médicale
L’étude du dossier et l’expertise médicale sont des étapes clés dans le parcours d’une victime d’agression au travail, surtout lorsqu’il s’agit d’obtenir une indemnisation juste et complète. L’avocat et le médecin conseil commencent par constituer un dossier complet, qui servira de base à l’expertise médicale et à la demande d’indemnisation. Ce dossier permet de documenter les préjudices : physiques, psychiques, économiques, sociaux.
Calcul des provisions et indemnisation finale
L’indemnisation d’une victime d’agression au travail se déroule en deux grandes phases : les provisions (avance sur indemnisation avant consolidation) et l’indemnisation finale (réparation intégrale du préjudice). Voici comment cela fonctionne en pratique :
1. Les provisions : une avance pour faire face à l’urgence
Les provisions sont des sommes versées avant la consolidation médicale, c’est-à-dire tant que l’état de santé n’est pas stabilisé.
🔹 Objectifs :
- Couvrir les frais médicaux immédiats
- Compenser les pertes de revenus
- Financer les aménagements temporaires (aide à domicile, transport, etc.)
🔹 Conditions :
- Le droit à réparation doit être établi, même partiellement
- La victime doit fournir des justificatifs (certificats médicaux, bulletins de salaire, etc.)
- La demande peut être faite auprès :
- De l’assurance (GAV, employeur, etc.)
- Du juge (dans le cadre d’une procédure civile ou pénale)
- De la CIVI (indemnisation des victimes d’infractions) si l’auteur est insolvable.
FAQ sur l’indemnisation d’une agression au travail
- Que faire en cas d’agression sur son lieu de travail ?
Porter plainte (commissariat, gendarmerie, ou directement au procureur). Garder une copie du dépôt de plainte. En cas de préjudice durable, il faudra envisager une action civile pour demander réparation (dommages et intérêts).
- Quels sont les 3 types d’agressions ?
Les Agressions physiques, les agressions verbales ou psychologiques, les Agressions matérielles.
- Est-il possible de reprendre le travail après une agression ?
Il est tout à fait possible de reprendre le travail après une agression, mais cela dépend de plusieurs facteurs : la gravité des séquelles, l’environnement professionnel, et surtout le rythme de rétablissement physique et psychologique de la victime. Avant toute reprise, il faut que l’état de santé soit stabilisé, Une visite de reprise avec le médecin du travail est obligatoire après un arrêt de travail de plus de 30 jours, la reprise peut se faire avec un aménagement de poste. La reprise ne doit pas empêcher la poursuite des démarches judiciaires ou d’indemnisation, la reconnaissance de l’agression comme accident du travail ou infraction pénale reste valable.
- L’agression au travail est-elle reconnue comme un accident du travail ?
Oui, une agression sur le lieu de travail peut tout à fait être reconnue comme un accident du travail. Selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail :« Un événement soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail, entraînant une lésion corporelle ou psychique. »
Cela inclut les agressions dès lors qu’elles ont lieu :
- Sur le lieu de travail
- Pendant les horaires de travail
- Ou lors d’un déplacement professionnel ou du trajet domicile travail
- Quels sont mes droits si je suis victime d’une agression au travail ?
Toute agression survenue à l’occasion ou sur le lieu de travail peut être reconnue comme un accident du travail et permet une prise en charge par la CPAM.
La victime peut déposer plainte contre l’auteur de l’agression, qu’il s’agisse d’un collègue, supérieur hiérarchique ou tiers extérieur (client, usager…).
- Que faire si mon agresseur n’est pas solvable ?
Si l’agression est reconnue comme une infraction pénale et que l’auteur est insolvable ou inconnu, la victime peut saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI).
- Puis-je contester l’évaluation de mon préjudice ?
On a le droit de contester l’évaluation du préjudice, que ce soit dans le cadre d’une procédure judiciaire, d’une expertise médicale ou d’une indemnisation par la CIVI ou une assurance (employeur, Garantie Accidents de la Vie).
- Combien puis-je obtenir comme indemnisation après une agression au travail ?
En cas de séquelles graves (ex. : incapacité permanente, handicap entraînant une invalidité), l’indemnisation peut dépasser 100 000 €, voire atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros.
- Quelle est la procédure pour déclarer une agression à mon employeur ?
Informer l’employeur par écrit de l’accident/agression (sous 24h si possible).Vérifier que l’employeur a bien déclaré l’accident à la CPAM.Si l’employeur refuse : déclarer soi-même l’accident à la CPAM dans les 2 ans.
- L’employeur peut-il être tenu responsable d’une agression au travail ?
L’agresseur (collègue, supérieur, client ou tiers) engage toujours sa responsabilité pénale. Selon le cas, il peut aussi engager sa responsabilité civile et être condamné à indemniser la victime.
L’employeur reste responsable de la sécurité des salariés et doit agir immédiatement, même si l’agresseur est extérieur à l’entreprise.
Découvrir nos autres articles pour les victimes d’agressions :
- Indemnisation des victimes d’une agression physique
- Indemnisation des victimes de violences conjugales
- Avocats spécialisé dans les agressions physiques
- Barèmes et calcul d’indemnisation suite à une agression
Découvrez les dossiers d’indemnisations traités par Indemnisation Préjudice : Exemples de dossiers à la suite d’agressions